- Text
- History
L'eau n'est un enjeu politique immé
L'eau n'est un enjeu politique immédiat que dans des zones bien précises: Moyen-Orient, Afrique des Grands Lacs.. Dans ces régions, se cumulent les facteurs de tension: les réserves en eau sont faibles, la population, avec la diffusion de la médecine, a crû considérablement durant les dernières décennies, les agriculteurs trop nombreux se disputent une terre rare et surexploitée, de grands projets d'industrialisation, visant parfois à satisfaire la mégalomanie des dirigeants, ignorent les contraintes naturelles, enfin, couronnant l'ensemble, les rivalités politiques sont multiples… Au Moyen-Orient, l'eau est un facteur d'antagonisme parmi beaucoup d'autres. L'élément déterminant est la situation politique, la présence d'Etats ne s'acceptant pas les uns les autres. Demain, si la paix s'installe, l'eau, que l'on se dispute âprement, sera nécessairement l'un des domaines-clé de la coopération entre anciens belligérants: l'eau étant rare, la paix ne s'enracinera que si cette ressource fait l'objet d'une exploitation commune. Désormais tout processus de paix inclut l'eau, la réconciliation entre des peuples exigeant qu'ils reconnaissent comme communs des éléments qui les séparaient. Ce qui change ici, c'est moins la perception de l'eau – certes de plus en plus indispensable, puisque de plus en plus consommée – que l'approche de la paix. Celle-ci ne doit plus être une simple trêve entre deux guerres, mais une démarche construite, établissant une entente durable entre des peuples par des projets communs sur de enjeux vitaux. Eau et paix se retrouvent liées.
0/5000
المياه تحدي سياسي فوري في مجالات محددة: الشرق الأوسط، "البحيرات الكبرى في أفريقيا"... وهذه المجالات عوامل التوتر التراكمي: احتياطيات المياه منخفضة، السكان، مع انتشار الطب، قد ازداد إلى حد كبير في العقود الأخيرة، العديد من المزارعين يقاتلون نادرة وعلى استغلال الأراضي، ومشاريع التصنيع كبيرة، أحياناً للوفاء بجنون العظمة القادة، وتجاهل القيود الطبيعية، أخيرا، تتويج المنافسات السياسية كاملة متعددة... في الشرق الأوسط، والمياه عاملاً عداء بين العديد من الآخرين. أن العامل الحاسم هو الحالة السياسية، ولا تقبل وجود الدول بعضها البعض. غدا، إذا كان السلام يأخذ عقد، الماء، نكافح الثابت، سوف تكون بالضرورة واحدة من المجالات الرئيسية للتعاون بين الأطراف المتحاربة السابقة: المياه النادرة، والسلام سوف الجذر فقط إذا كان هذا المورد عملية مشتركة. يتضمن أي عملية السلام الآن المياه، والمصالحة بين الشعوب التي تطالب بأن تعترف بأنها كالعناصر المشتركة التي تفصل بينهما. ما يتغير هنا، أنها أقل تصور للمياه-أكثر غنى، تستهلك أكثر فأكثر-نهج السلام. لم يعد ينبغي أن يكون هدنة بسيطة بين الحربين، ولكن نهجاً شيدت، وضع اتفاق مستدامة بين الشعوب من خلال مشاريع مشتركة بشأن القضايا الحيوية. هي ذات الصلة بالمياه والسلام.
Being translated, please wait..
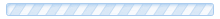
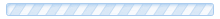
المياه هي قضية سياسية مباشرة أن في مجالات محددة هي: منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا البحيرات العظمى .. في هذه المناطق تتراكم عوامل الإجهاد: احتياطيات المياه منخفضة، والسكان، مع توزيع الأدوية، نمت بشكل كبير في العقود الأخيرة، وأيضا العديد من المزارعين تخوض الأرضية النادرة والإفراط في استغلال، ومشاريع التصنيع الرئيسية، وأحيانا لإرضاء جنون العظمة من القادة وتجاهل القيود الطبيعية، وأخيرا تتويج عموما، الخصومات السياسية كثيرة ... في الشرق الأوسط، والماء هو مصدر العداء بين العديد من الآخرين. إن العامل الحاسم هو الوضع السياسي، وجود الدول لا يقبل كل منهما الآخر. غدا، إذا أريد للسلام هو الماء، الذي هو والنزاع ساخن بالضرورة واحدة من المجالات الرئيسية للتعاون بين المتحاربين السابقة: المياه شحيحة، والسلام تترسخ أن إذا كانت هذه الموارد هو موضوع عملية مشتركة. الآن تشمل أي عملية سلام المياه والمصالحة بين الشعوب مطالبين أن من العناصر المشتركة بينهما. ما هي التغييرات هنا هي أقل التصور من الماء - وإن كان على نحو متزايد أساسي، والمزيد والمزيد المستهلكة - نهج السلام. هذا لم يعد ينبغي أن يكون مجرد هدنة بين حربين ونهج بناء، تأسيس فهم دائم بين الشعوب من خلال مشاريع مشتركة حول القضايا الحيوية. تم العثور على ربط الماء والسلام.
Being translated, please wait..
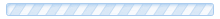
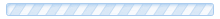
الماء هو مسألة سياسية واضحة على الفور في منطقة البحيرات الكبرى: الشرق الأوسط، أفريقيا.في هذه المناطق، تداخل عوامل التوتر: انخفاض احتياطيات المياه السكان ونشر الطب، زيادة كبيرة في العقود القليلة الماضية، المزارعين الكثير من المشاحنات و النادرة surexploit é e مشاريع كبيرة التصنيع لتلبية القادة في بعض الأحيان الغطرسة، تجاهل القيود الطبيعية وأخيرا جميع المنافسة السياسية، ولي، هو.......... في منطقة الشرق الأوسط، الماء هو نوع من محاربة العديد من العوامل.المهم هو الوضع السياسي، لا يوجد في الدولة لا تقبل الآخر.غدا، إذا استقر السلام، والمياه، لدينا الكثير من الجدل حتمية التعاون في المجالات الرئيسية هي: المياه القديمة النادرة في الحرب، السلام، إذا لم يتم حماية هذه الموارد في التنمية المشتركة.الآن، أي المصالحة بين عملية السلام، بما في ذلك المياه، الشعب يطالب واعترفت العناصر المشتركة بين.هذا التغيير، ليس هذا هو التصور المياه – أكثر أهمية، بالطبع، لأن المزيد والمزيد من استهلاك – طريقة السلام.لم يعد مجرد حربين بين وقف إطلاق النار، ولكن هذه الخطوة إنشاء المستدامة فهم الشعب بين البنود المشتركة في القضايا الهامة.الماء و السلام ذات الصلة.
Being translated, please wait..
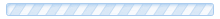
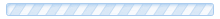
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.
- Now, I understand that you need privacy
- Peristiwa G30S/PKI atau biasa disebut de
- Vì bang đó ít người Việt Nam và tôi có t
- Peristiwa G30S/PKI atau biasa disebut de
- Would you give me a moment?
- ขอโทษที่ฉันเป็นเพื่อนที่ไม่ดี ฉันทำให้เธ
- ignore context switching and natural wai
- Changes in cucumber hypocotyl cell wall
- monochorionic-monoamniotic twins
- i offer petsitting services in the home
- Mass tourism
- คณะกรรมการจะสามารถพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบ
- I don't mind what other people call me.
- Now, I understand that you need privacy
- Getting into a car accident can lead to
- I highly suggest that you wait for your
- Getting into a car accident can lead to
- The first stage of the reaction (Eqs. (8)
- progettare la ricerca
- ฉันต้องการที่อยู่ของ No.7
- We previously reported that Azospirillum
- Can you give me a moment?
- Cyanate is also oxidised to give N2 and
- Tại vì bang đó ít người Việt Nam và tôi

